À première vue, Estaimpuis semble être une tranquille commune de la province de Hainaut. Mais sa situation géographique, longée par 23 kilomètres de frontière avec la France, en fait un véritable laboratoire de la coopération transfrontalière en matière de sécurité. On pourrait croire à un remake du film « Rien à déclarer » mais il n'en est rien. Le sujet est, on ne peut plus sérieux, entre vols, trafics et courses-poursuites illustrent la complexité de la criminalité dans cette région, où la frontière ne constitue pas un obstacle pour les délinquants.
Une collaboration devenue incontournable
Face à la montée de la délinquance transfrontalière, la Belgique et la France ont mis en place des mécanismes de collaboration de plus en plus étroits. Les forces de police organisent des patrouilles mixtes, coordonnent leurs contrôles et échangent des informations en temps réel pour prévenir les incidents. Ces opérations conjointes permettent notamment d’éviter que des criminels profitent des différences juridiques entre les deux pays pour échapper à la justice.
« Les malfrats connaissent le cadre juridique mieux que nous », confie un officier belge, rappelant que sans coopération efficace, la frontière peut devenir un refuge stratégique pour les auteurs d’infractions.

Formation et échanges : une nouvelle culture policière transfrontalière
Au-delà des interventions sur le terrain, des formations conjointes sont régulièrement organisées. Ces sessions sensibilisent les policiers belges et français aux subtilités juridiques et opérationnelles de l’autre pays. L’objectif est double : renforcer l’efficacité des interventions et éviter les malentendus ou infractions involontaires lors des opérations transfrontalières.
Cette démarche illustre une transformation culturelle de la police dans la région : l’interdépendance entre forces belges et françaises devient la norme plutôt qu’une exception.
Des incidents qui rappellent les limites de la juridiction
Malgré ces efforts, la frontière reste un défi opérationnel. Lors d’une course-poursuite commencée en France et terminée à Estaimpuis, des policiers français ont franchi la frontière sans autorisation, mettant en lumière les limites juridiques des interventions transfrontalières.
Ces situations montrent que la coopération ne peut se réduire à des patrouilles mixtes : elle nécessite également une clarification des droits et devoirs de chaque force, afin d’éviter les conflits de compétence et les tensions diplomatiques.
Un cadre légal pour encadrer la coopération
Pour faciliter les interventions transfrontalières, des accords bilatéraux, comme les accords de Tournai II, ont été signés entre la Belgique et la France. Ces textes prévoient la mise en place de Centres de Coopération Policière et Douanière (CCPD), permettant aux forces des deux pays de partager informations et ressources.
Ces structures ont pour objectif d’assurer une collaboration structurée, où chaque intervention est planifiée et conforme au droit national, tout en répondant aux exigences d’efficacité sur le terrain.
L’exemple d’Estaimpuis : une frontière qui devient laboratoire
Estaimpuis illustre parfaitement les enjeux de la coopération policière en Europe. Ici, la frontière n’est plus seulement une ligne administrative : elle devient un espace de coordination, d’apprentissage et d’expérimentation, où les forces de l’ordre apprennent à conjuguer efficacité et respect des juridictions.
Si les défis sont nombreux – gestion des juridictions, formation continue, coordination en temps réel – l’expérience d’Estaimpuis montre que la collaboration transfrontalière est possible et peut servir de modèle pour d’autres régions frontalières en Europe.

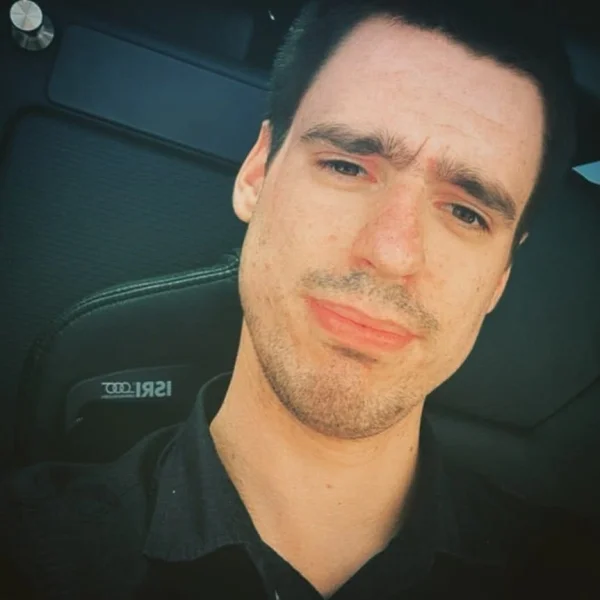













Commentaires (0)